
Par Pierre Blavin
Fusion et adaptation des deux exposés de présentation.
En Belgique, « On ne sait pas le français, personne ne le sait, mais tout le monde affecte de ne pas savoir le flamand. C’est de bon goût. La preuve qu’ils le savent bien, c’est qu’ils engueulent leurs domestiques en flamand », c’est ce qu’écrit Baudelaire, entre autres amabilités adressées au peuple belge, peuple qu’il ose décrire « sans âme » et haïssant la littérature. Il publie ce pamphlet ou plutôt ses notes pamphlétaires en 1864, soit 34 ans après la création du Royaume fédérant pays flamand et pays wallon.
Il est vrai que pendant une cinquantaine d’années à partir de cette fondation, aucune œuvre poétique majeure ne s’est publiée en Belgique. Mais, à partir de 1880, voici que paraissent tout à coup les premiers numéros d’une trentaine de revues qui appellent à un renouveau de la poésie d’expression française. Selon la formule de l’écrivain Claude Lemonnier, une « ivresse de littérature » se manifeste dans le pays. Les titres des revues les plus influentes, La Jeune Belgique, L’Art moderne et La Wallonie, montrent déjà quelque chose des préférences qui s’y expriment et des débats parfois houleux qui s’y développent à propos du contenu du renouveau souhaité par tous.
Nés entre 1851 et 1862, les poètes belges qui, à partir de 1881 et jusqu’aux années 1920, vont s’illustrer en poésie française, appartiennent, sauf Hannon et Gilkin, à des familles flamandes, vivant donc dans un contexte néerlandophone : paradoxe étonnant mais qui rend compte de l’aura du français dans les milieux aisés flamands ! Ils ont tous grandi dans des milieux bourgeois et catholiques. Tous, ils ont fait leurs études dans des établissements francophones. Ils sont plusieurs à avoir étudié le droit... et à l’avoir abandonné au profit de la poésie. Au fil des lectures, on peut remarquer bon nombre d’autres points communs entre eux, notamment la tendance à une mélancolie profonde, par exemple dans les évocations de leur plat pays gris hérissé de tours (les beffrois) : il y en a beaucoup, en particulier dans les poèmes de Verhaeren, Maeterlinck et Rodenbach. Et puis, la présence très marquée chez la plupart d’entre eux de thèmes religieux.
Après avoir exploré le 20 janvier les œuvres de Théodore Hannon et Iwan Gilkin, qui continuent sur la lancée du Parnasse et de Baudelaire, puis celles des « décadents » ou symbolistes Émile Verhaeren et Maurice Maeterlinck, nous avons poursuivi le 24 mars avec Georges Rodenbach, Charles Van Lerberghe, Max Elskamp, et aussi un peu avec Grégoire le Roy, dont le rythme harmonieux des poèmes me plaît beaucoup. Albert Mockel est également un des poètes belges qui ont compté à cette époque, mais sans doute davantage par ses « Propos de littérature », où il tente de définir le symbolisme que par ses propres poèmes. Je retiens de ces « Propos » cette phrase : « [...] le Poète doit chercher moins à conclure qu’à donner à penser, de telle sorte que le lecteur, collaborant par ce qu’il devine, achève en lui-même les paroles écrites ». Durant ces deux soirées, nous avons prolongé en nous les mots des poètes...
Théodore Hannon (1851-1916)
 Il était peintre, critique d’art et poète. Son recueil Rimes de joie est la première œuvre du mouvement de renouveau. On parle rarement de symbolisme à son propos, il serait plutôt un héritier de Baudelaire. Ses sujets sont exotiques parfois et souvent érotiques, avec une attention particulière portée aux sensations olfactives, aux couleurs et aux artifices, au maquillage.
Il était peintre, critique d’art et poète. Son recueil Rimes de joie est la première œuvre du mouvement de renouveau. On parle rarement de symbolisme à son propos, il serait plutôt un héritier de Baudelaire. Ses sujets sont exotiques parfois et souvent érotiques, avec une attention particulière portée aux sensations olfactives, aux couleurs et aux artifices, au maquillage.
* * * Lecture de ses poèmes ***
Dans sa préface aux Rimes de joie, Joris-Karl Huysmans parle de la « délicatesse de touche » et de la « légèreté de doigté » de Théodore Hannon, l’un des seuls, dit-il, « qui a la curiosité des parfums agressifs, des luxes désordonnés des dessous, des opulences maquillées des dessus ». Et il ajoute que ce « poète singulier et neuf a bravement, avec certaines pièces de ce livre, emboîté le pas, derrière le grand maître ». Ce « grand maître », vous l’avez deviné, c’est Baudelaire.
C’est bien à Baudelaire souvent que l’on pense aussi en lisant les poèmes d’Iwan Gilkin. Mais surtout le Baudelaire cru et satanique.
Iwan Gilkin (1858-1924)
 Pourtant, ce que Gilkin, qui était aussi essayiste et critique, a défendu avec la plus grande énergie, notamment dans La Jeune Belgique, c’est le Parnasse. Il en appréciait la recherche de formes parfaites et l’idée de l’Art pour l’Art. Le style et la métrique de ses poèmes témoignent de ces convictions fortes.
Pourtant, ce que Gilkin, qui était aussi essayiste et critique, a défendu avec la plus grande énergie, notamment dans La Jeune Belgique, c’est le Parnasse. Il en appréciait la recherche de formes parfaites et l’idée de l’Art pour l’Art. Le style et la métrique de ses poèmes témoignent de ces convictions fortes.
Il avait conçu une trilogie, dont La Nuit, d’où sont tirés les poèmes pour ce soir, devait être le premier élément, précédant L’Aube, c‘est-à dire le Purgatoire, et La Lumière, à savoir le Paradis. Il n’a en fait jamais écrit L’Aube ni La Lumière. Ne reste que La Nuit, c’est-à-dire l’Enfer. Un tel sujet lui a fourni matière à donner franchement dans le satanisme et dans des descriptions d’un réalisme parfois difficilement supportable, j’en ai choisi un exemple frappant (le poème « Stercocaires »). Il faut dire que c’était à la mode à l’époque, et c’est pour cela que ce parnassien-baudelairien a été considéré comme un poète du mouvement « décadent » qui a précédé le symbolisme puis cohabité avec lui. De Gilkin, un de ses amis, Valère Gille, a dit qu’il « a donné son consentement à la philosophie du pessimisme. Le problème du Mal le hante. Il est chrétien et catholique, et Satan est le Roi du Mal. Il dépiste celui-ci avec une froide audace. Il le dépiste partout ; [...] il l’analyse avec une fiévreuse lucidité ».
* * * Lecture de ses poèmes ***
Dans un article d’une grande subtilité, Maurice Maeterlinck dit de l’œuvre de Gilkin qu’elle « [...] est terrible entre toutes. On assiste au cours des ces pages à un drame asphyxiant au fond d’une conscience anormalement obscure ». Cette remarque s’accompagne d’une analyse très originale du sadisme tel qu’il s’exprime dans La Nuit.
Émile Verhaeren (1855-1916)
 Gilkin, lui, sera plus violent dans sa critique dudit Maeterlinck, nous verrons cela plus tard, et de Verhaeren. Ce dernier, selon lui, s’exprimait en « un baragouin d’apache [...] bouleversant les mots dans un irrémédiable gâchis ». Appréciation surprenante pour l’œuvre de Verhaeren, certes parfois un peu lourde, mais d’une puissance et d’une variété d’inspiration extraordinaires. Nous en avons eu quelque idée lors de la soirée que nous lui avons consacrée il y a quelques mois. Aussi ai-je réduit ici à la portion congrue la partie concernant ce poète important.
Gilkin, lui, sera plus violent dans sa critique dudit Maeterlinck, nous verrons cela plus tard, et de Verhaeren. Ce dernier, selon lui, s’exprimait en « un baragouin d’apache [...] bouleversant les mots dans un irrémédiable gâchis ». Appréciation surprenante pour l’œuvre de Verhaeren, certes parfois un peu lourde, mais d’une puissance et d’une variété d’inspiration extraordinaires. Nous en avons eu quelque idée lors de la soirée que nous lui avons consacrée il y a quelques mois. Aussi ai-je réduit ici à la portion congrue la partie concernant ce poète important.
Homme de contrastes, célébrant tour à tour au début de sa carrière poétique les flamandes d’autrefois à la « lourde beauté », à la « gorge fleurie », ou les « Moines apostoliques, « flambeaux de foi, porteurs de feu » ; regrettant les villages d’antan, les campagnes paisibles, mais glorifiant l’effort humain, le progrès des villes et, en même temps, leur folie et leurs vices ; passant d’un certain nombrilisme à un humanisme universel ; livrant à côté des longs textes exprimant tout cela de nombreuses petites pièces où se déploient les charmes d’un amour charnel, tendre et durable. Pour ce soir, je n’ai retenu que quatre poèmes de lui, un paysage vespéral très coloré et suggestif, des extraits d’un long poème sur les contrastes de la ville et deux poèmes d’amour.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
Dans le livre qu’il a consacré à Verhaeren, Stefan Zweig a écrit : « Sa poésie n’incline pas à la rêverie, comme la musique ; elle ne symbolise pas, comme la peinture : elle agit, à la façon d’un vin généreux ».
Maurice Maeterlinck (1862-1949)
 Il n’aurait certes pas pu dire cela de la poésie de Maurice Maeterlinck. Celle-ci, à mon avis, est une rêverie, incline sans doute à la méditation et occupe une place à part parmi les autres œuvres qui ont beaucoup compté pour le Prix Nobel de littérature qu’il a reçu en 1911 : ses pièces de théâtre, dont Pelléas et Mélisande, qui inspirera des musiques à Wallace, Fauré, Debussy, Schonberg et Sibélius, L’Oiseau bleu, et ses essais : La Vie des abeilles, L’Intelligence des fleurs, pour ne parler que de ce qui est paru avant 1911.
Il n’aurait certes pas pu dire cela de la poésie de Maurice Maeterlinck. Celle-ci, à mon avis, est une rêverie, incline sans doute à la méditation et occupe une place à part parmi les autres œuvres qui ont beaucoup compté pour le Prix Nobel de littérature qu’il a reçu en 1911 : ses pièces de théâtre, dont Pelléas et Mélisande, qui inspirera des musiques à Wallace, Fauré, Debussy, Schonberg et Sibélius, L’Oiseau bleu, et ses essais : La Vie des abeilles, L’Intelligence des fleurs, pour ne parler que de ce qui est paru avant 1911.
La première fois qu’on lit son recueil de poésie, Serres chaudes, on peut être décontenancé : il y est question de serres, de cloches de verre ou de cristal bleu, d’hôpitaux, de mystiques prières, de « rêves qui se lassent », d’ennui... Et la présence de malades, de lis et d’agneaux devient obsédante. On peut se demander quel peut bien être son problème existentiel ! Or rien de déterminant n’a été relevé dans la vie de cet écrivain, avocat, jardinier et apiculteur qui puisse expliquer ces images récurrentes. Je vous invite à ne pas trop vous poser ce genre de questions et à vous laisser envoûter par les obsessions qui s’expriment et les rythmes divers, vers réguliers, irréguliers, vers avec rimes ou sans rimes, qui confèrent à ces poèmes des musiques et des significations multiples et singulières.
Les trois derniers textes sélectionnés, plus proches d’une poésie populaire et rappelant la tradition de la ballade allemande, le lied, appartiennent au recueil Quinze chansons.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
Giklkin n’a vu dans les Serres chaudes qu’un « amalgame de métaphores désorbitées » ; Au contraire, pour Verhaeren, dans la revue Art Moderne, « C’est neuf à faire craquer toutes les habitudes, et on ressent la jouissance ineffable que donne l’inédit ». Neuf et jouissif, oui ! On présente souvent ce recueil comme représentant un courant important du symbolisme. En même temps, le recours à l’image de la serre et de la cloche de verre ou de l’aquarium (titre d’un des poèmes) et aux symboles tout faits comme le lis et les agneaux est un artifice bien digne des poètes dits « décadents ». Au-delà de cette remarque qui relève de la polémique littéraire, je vous livre l’explication que donne Paul Gorceix dans son ouvrage sur les poètes belges de cette époque : « La serre, c’est l’espace où se situe l’enfermement de l’âme, la clôture du moi, qui, du dedans, tel le voyageur impuissant, assiste à travers la vitre aux tentations du dehors ». Explication tout aussi plausible pour la cloche de verre, l’aquarium ou même l’hôpital.
Georges Rodenbach (1855-1898)
 Né la même année que Verhaeren et élève au même moment que lui au Collège jésuite Sainte Barbe à Gand, il a, comme lui entrepris des études de droit. Mais, contrairement à Verhaeren, il a été par la suite un brillant avocat. Longtemps malade, c’est d’une appendicite qu’il meurt à 43 ans. Son ami Verhaeren lui survivra jusqu’à ce qu’un train le fauche dix-huit ans après.
Né la même année que Verhaeren et élève au même moment que lui au Collège jésuite Sainte Barbe à Gand, il a, comme lui entrepris des études de droit. Mais, contrairement à Verhaeren, il a été par la suite un brillant avocat. Longtemps malade, c’est d’une appendicite qu’il meurt à 43 ans. Son ami Verhaeren lui survivra jusqu’à ce qu’un train le fauche dix-huit ans après.
C’est par un roman que Rodenbach a été vraiment connu bien au-delà du public littéraire : Bruges-la Morte. Le personnage essentiel en est la ville elle-même, séjour qu’a choisi le narrateur pour sa ressemblance avec son propre état d’âme : « Mélancolie de ce gris des rues de Bruges où tous les jours ont l’air de la Toussaint ! Ce gris comme fait avec le blanc des coiffes de religieuses et le noir des soutanes de prêtres, d’un passage incessant ici et contagieux. Mystère de ce gris, d’un demi-deuil éternel ! » Le gris, le noir, le blanc sont les couleurs (si l’on peut dire !) dominantes dans les alexandrins fluides et ô combien harmonieux de ses différents recueils.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
À propos de la poésie de son ami, Verhaeren a écrit : « Ce qui distingue les poèmes de M. Rodenbach, c’est l’abondance de leurs images ; ce qui distingue ces images, c’est leur tremblé, leur ténuité, leur frôlement ». Et on a gardé plusieurs lettres admiratives de Mallarmé à Rodenbach : « [...] vos poèmes [...] comptent parmi les plus purs et les miraculeux que j’aie lus [...] », chaque vers étant « un coup d’archet bien rare ».
Charles Van Lerberghe (1861-1907)
 Encore un élève des jésuites du Collège Sainte Barbe à Gand ! Lui, c’est Maeterlinck et Grégoire le Roy qu’il a eus comme condisciples. Mais ce n’est pas vers le droit qu’il s’est d’abord dirigé, il a fait des études de philosophie et de littérature à Bruxelles.
Encore un élève des jésuites du Collège Sainte Barbe à Gand ! Lui, c’est Maeterlinck et Grégoire le Roy qu’il a eus comme condisciples. Mais ce n’est pas vers le droit qu’il s’est d’abord dirigé, il a fait des études de philosophie et de littérature à Bruxelles.
C’était un grand admirateur de Mallarmé et de Wagner. Aspirations non réalisées et déceptions ont, paraît-il, caractérisé sa vie. Il exprimait ainsi, à propos de son recueil Entrevisions, sa « vision d’art » : « un balbutiement, un murmure d’extase devant la beauté entrevue dans une soudaine lumière - et puis perdue ». Il est aussi l’auteur lyrique d’un très long ensemble de poèmes (près de 2 000 vers) intitulé La chanson d’Ève, autour du mythe biblique de la première femme.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
On vient de le lire, la longue histoire de la prétendue « faute » se termine par une danse tourbillonnante d’Ève en véritable « apothéose de sensualité », comme l’écrit un critique...
Pour Maurice Maeterlinck, son ancien condisciple de Sainte-Barbe, Van Lerberghe est le « poète le plus pur, le plus entièrement, le plus foncièrement poète qu’avec Verlaine, le XIXe siècle ait vu naître ».
 Grégoire Le Roy (1862-1941)
Grégoire Le Roy (1862-1941)
À part une analyse de sa poésie par le poète français Pierre Quillard, disponible sur Internet, je n’ai pas trouvé de renseignements sur ce poète, dont je vous propose deux poèmes empreints de nostalgie romantique.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
Max Elskamp (1862-1931)
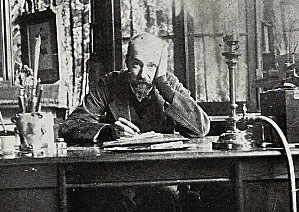 Fils d’un riche armateur, marin lui-même voyageant plusieurs années en Europe et dans le bassin méditerranéen après ses études de droit et un bref exercice de la profession d’avocat, il est connu pour avoir été un grand collectionneur d’objets rares et pour avoir vécu après 1920 de longues années en reclus. D’ailleurs, malade, il est mort à Anvers, où il était né ; il avait perdu la raison.
Fils d’un riche armateur, marin lui-même voyageant plusieurs années en Europe et dans le bassin méditerranéen après ses études de droit et un bref exercice de la profession d’avocat, il est connu pour avoir été un grand collectionneur d’objets rares et pour avoir vécu après 1920 de longues années en reclus. D’ailleurs, malade, il est mort à Anvers, où il était né ; il avait perdu la raison.
C’est, à mes yeux, un poète au style déconcertant : archaïsmes, tournures syntaxiques bizarres, rythmes de chanson constituent une œuvre d’allure à la fois naïve et raffinée. Le collectionneur se lit souvent dans l’évocation d’objets chinois ou japonais. L’intérêt de Max Elskamp se manifeste aussi pour le Moyen Âge non seulement occidental mais oriental. Et, si quelques poèmes évoquent les rencontres éphémères de belles dames, beaucoup sont à fortes connotations religieuses. La Vierge Marie y apparaît souvent
Marie des choses ineffables,
Marie de pures senteurs
Marie du soleil et des pluies.
On y rencontre aussi des personnages de la Bible, comme Salomé. Et l’on remarque l’impression profonde que lui fait le bouddhisme, sa fascination devant l’idée de métempsycose, et même son adhésion aux enseignements de Bouddha, comme on peut l'entendre dans le dernier poème sélectionné pour ce soir.
* * * Lecture de ses poèmes * * *
Il n’y a pas eu véritable conversion d’Elskamp au bouddhisme. De nombreux poèmes postérieurs évoquent l’humilité du pécheur qui fait son mea culpa devant le Dieu chrétien de son enfance.
Sur la poésie de Max Elskamp, j’ai bien aimé ce commentaire de Remy de Gourmont : « Il y a des traces d’obscurité spontanée dans la poésie de Max Elskamp et aussi des traces de préciosité : l’expression, qui est toujours originale, l’est parfois avec gaucherie. Dans les pages parfaites, la pureté est délicieuse, nuancée comme un humide ciel flamand, transparente comme l’air du soir au-dessus des dunes et des canaux ; dans toutes, on a l’impression d’une constante recherche d’art, d’une passion charmante pour les nouvelles manières de dire l’éternelle vie ».
Conclusion générale
.jpg) L’ouvrage qui m’a donné l’idée de proposer ces deux soirées a été publié en 1998. Il est de Paul Gorceix, aujourd’hui décédé, qui était à l’époque professeur à l’Université de Bordeaux. Il s’intitule Fin de siècle et symbolisme en Belgique et se présente à la fois comme une série d’études et une anthologie. Si, pour ces deux soirées, je n’ai pas repris le titre du livre, c’est d’une part que plusieurs œuvres retenues dans cette anthologie et dans ma sélection ont été écrites après 1900, et, d’autre part, que je n’accorde qu’un crédit limité aux étiquettes du type « symbolistes ». Disons qu’il s’agit de poètes qui ont écrit dans une période où l’on discutait beaucoup de ce que pouvait être le symbolisme en poésie. Mais ils n’ont pas tous été considérés par tout le monde comme des symbolistes.
L’ouvrage qui m’a donné l’idée de proposer ces deux soirées a été publié en 1998. Il est de Paul Gorceix, aujourd’hui décédé, qui était à l’époque professeur à l’Université de Bordeaux. Il s’intitule Fin de siècle et symbolisme en Belgique et se présente à la fois comme une série d’études et une anthologie. Si, pour ces deux soirées, je n’ai pas repris le titre du livre, c’est d’une part que plusieurs œuvres retenues dans cette anthologie et dans ma sélection ont été écrites après 1900, et, d’autre part, que je n’accorde qu’un crédit limité aux étiquettes du type « symbolistes ». Disons qu’il s’agit de poètes qui ont écrit dans une période où l’on discutait beaucoup de ce que pouvait être le symbolisme en poésie. Mais ils n’ont pas tous été considérés par tout le monde comme des symbolistes.
Il me paraît cependant assez clair que, sauf peut-être les deux premiers - Hannon et Gilkin - très influencés encore par le Parnasse et Baudelaire -, les poètes dont nous avons écouté quelques œuvres en janvier et en mars ont souvent, selon la formule de Mockel, moins « conclu » que « donné à penser ». Et la profonde mélancolie qui baigne si souvent leurs poèmes s’inscrit bien dans la tonalité générale de la poésie qualifiée de symboliste.
Quelles furent au XXe siècle les suites de cet éveil étonnant, surtout via la poésie, de la littérature francophone en Belgique ? Citons au moins, pour le roman : Georges Simenon et Françoise Mallet-Joris, sans oublier Amélie Nothomb. Pour la poésie, Henri Michaux (naturalisé français en 1955) et Norge, que Madeleine Briand nous a présenté à la Cave. Enfin comment ne pas faire allusion au poète chanteur qui enchanta tant d’entre nous : Jacques Brel, bien sûr !
_______________________________________________________________________________________
Ont participé aux lectures :
Catherine Havel, Christian Richard, Claude Mercutio, Denise Grouard, François Besnard, Geneviève Castang, Gérard Trougnou, Hélène Lustman, Jean-François Marsat, Jean-François Blavin, Loïc Bénard, Lucie Édouard, Lyse Bonneville, Maryse Gévaudan, Nicole Durand, Philippe Marineau, Pierre Blavin, Thierry Sajat et Vincent Marie.
________________________________________________________________________________________
